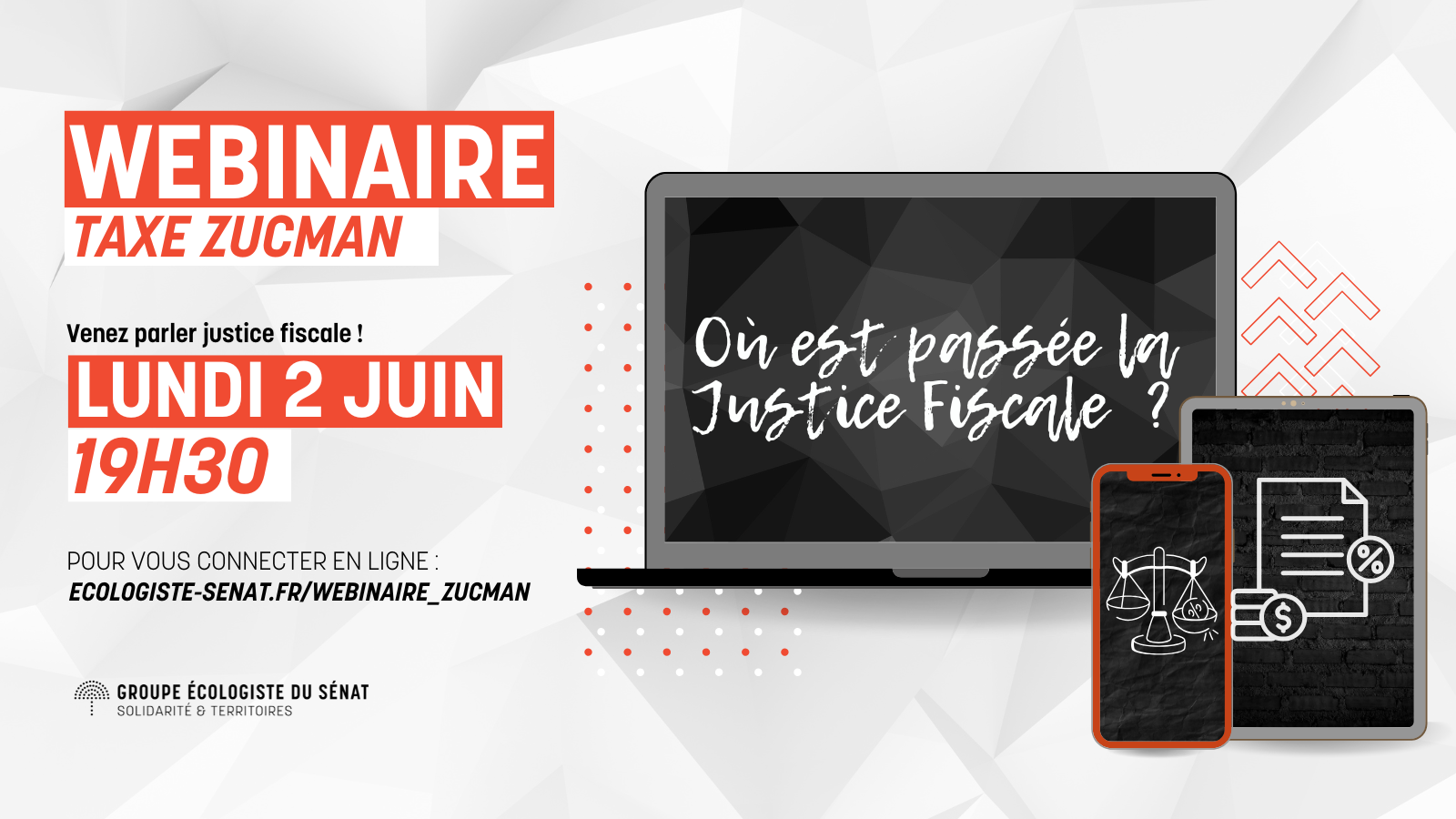
Venez parler justice fiscale avec le groupe Écologiste au Sénat !
Lundi 2 juin, venez parler justice fiscale avec le groupe Écologiste au Sénat lors d’un webinaire en ligne.
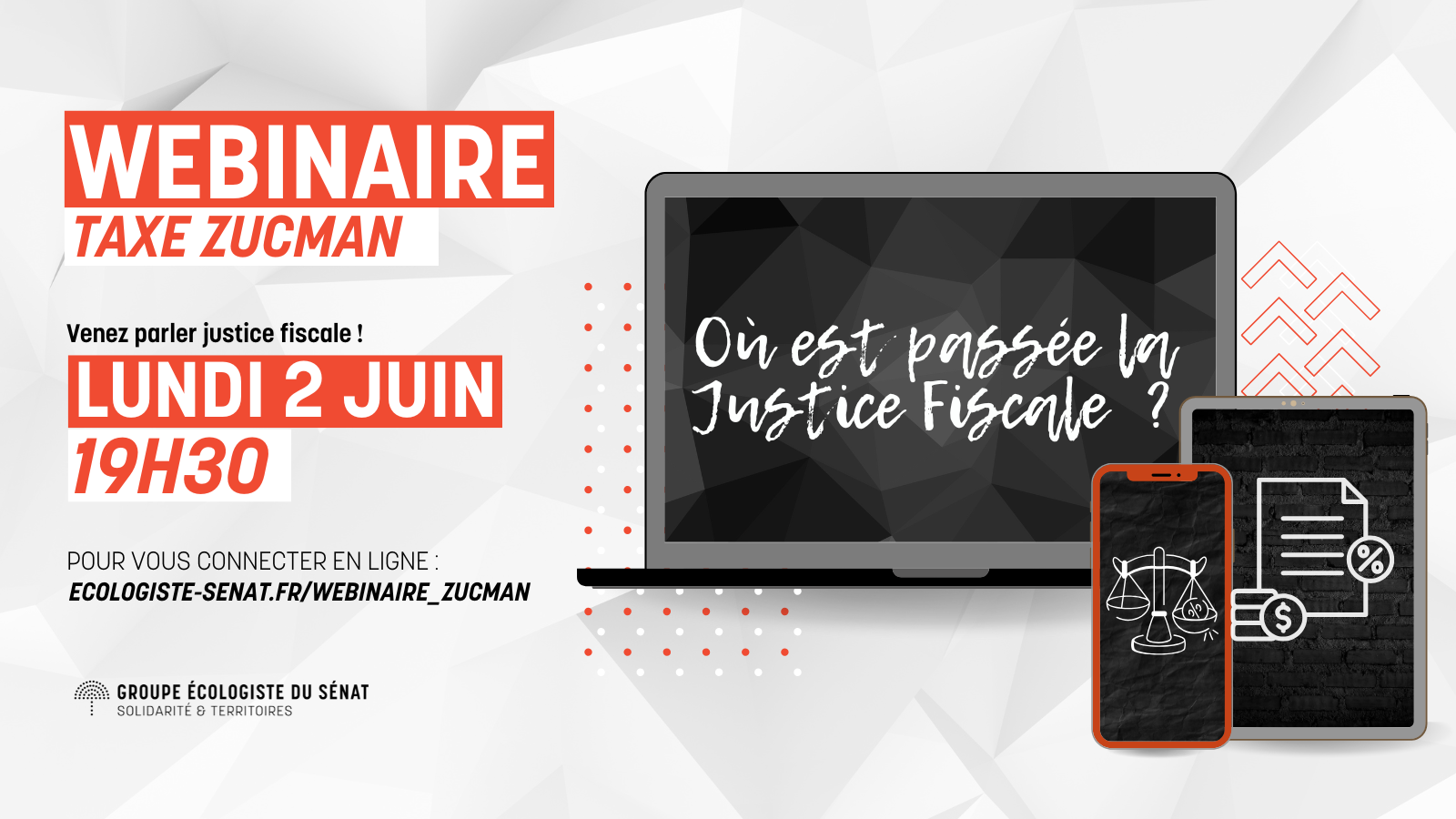
Lundi 2 juin, venez parler justice fiscale avec le groupe Écologiste au Sénat lors d’un webinaire en ligne.
Inscrivez-vous à la lettre d’information du Groupe Écologiste au Sénat !

Venez échanger avec Daniel Salmon et Mélanie Vogel sénateur/sénatrice écologistes ce mardi 28 janvier en ligne sur zoom !
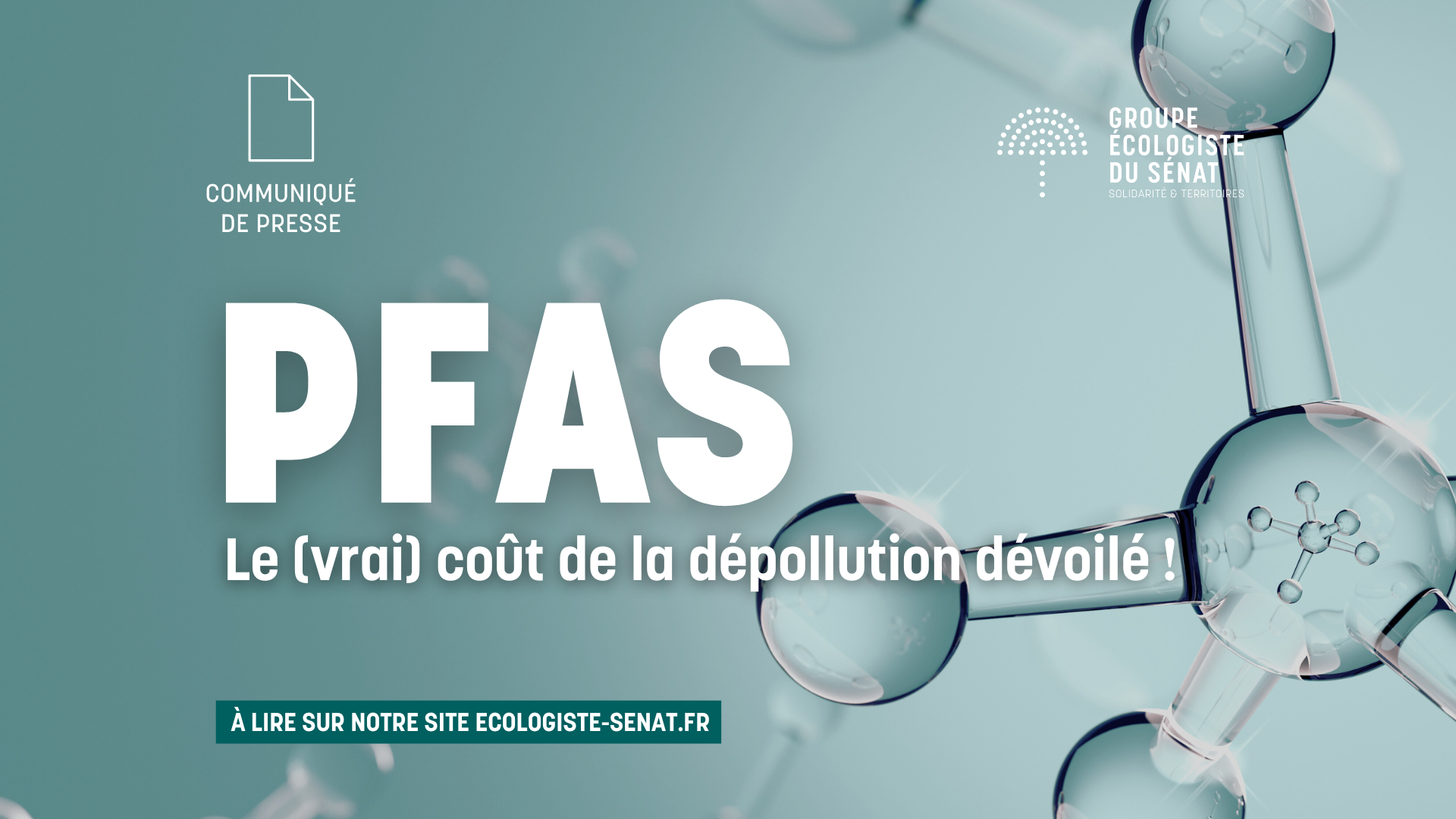
Le (vrai) coût de la dépollution des PFAS dévoilé : nous demandons leur interdiction et l’application du principe pollueur-payeur.